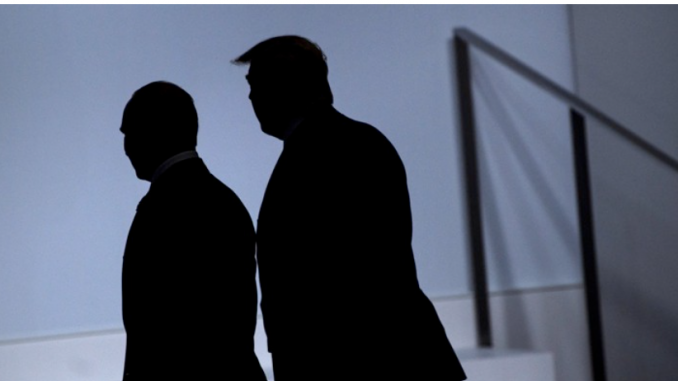
Convoqué à la hâte sans la participation de l’Ukraine, le sommet est « amateur et il est peu probable qu’il produise de vrais résultats », déclare Donald Heflin, aujourd’hui professeur à Tufts.
Un sommet organisé à la hâte entre le président Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine est prévu pour le 15 août 2025 en Alaska. Les deux dirigeants y discuteront d’un accord de paix entre la Russie et l’Ukraine. Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy n’y assistera pas , sauf changement de dernière minute. Naomi Schalit, rédactrice politique de The Conversation, a interviewé Donald Heflin , diplomate de longue date et enseignant à la Fletcher School de l’université Tufts, afin de recueillir son point de vue sur cette rencontre atypique et d’expliquer pourquoi elle est susceptible de déboucher, comme il le dit, sur une photographie et une déclaration, mais pas sur un accord de paix.
Comment se terminent les guerres ?
Les guerres prennent fin pour trois raisons. La première est que les deux camps, épuisés, décident de faire la paix. La seconde, plus fréquente, est que l’un des camps, épuisé, lève la main et déclare : « Oui, nous sommes prêts à négocier la paix. »
Et troisièmement – nous l’avons vu au Moyen-Orient – des forces extérieures comme les États-Unis ou l’Europe interviennent et disent : « Ça suffit. Nous imposons notre volonté de l’extérieur. Arrêtez ça. »
Ce que nous avons vu dans la situation entre la Russie et l’Ukraine, c’est qu’aucune des deux parties n’a montré une réelle volonté d’aller à la table des négociations et de céder du territoire .
Les combats continuent donc. Et le rôle joué actuellement par Trump et son administration est celui de cette troisième possibilité : une puissance extérieure intervient et dit : « Assez. »
Il faut maintenant considérer la Russie. La Russie est peut-être une ancienne superpuissance, mais c’est une puissance, dotée de l’arme nucléaire et d’ une armée imposante . Ce n’est pas un petit pays du Moyen-Orient que les États-Unis peuvent totalement dominer. Ils sont presque à égalité. Alors, peut-on vraiment leur imposer sa volonté et les amener à s’asseoir à la table des négociations avec sérieux s’ils ne le souhaitent pas ? J’en doute.
Comment cette prochaine rencontre entre Trump et Poutine s’inscrit-elle dans l’histoire des négociations de paix ?
L’analogie la plus courante est celle de la conférence de Munich de 1938, où la Grande-Bretagne a rencontré l’Allemagne hitlérienne. Je n’aime pas faire de comparaisons avec le nazisme ou l’Allemagne hitlérienne. Ces hommes ont déclenché la Seconde Guerre mondiale, perpétré l’Holocauste et tué 30 ou 40 millions de personnes. Difficile de comparer quoi que ce soit à cela.
Mais en termes diplomatiques, remontons à 1938. L’Allemagne a déclaré : « Écoutez, nous avons tous ces citoyens allemands qui vivent dans ce nouveau pays, la Tchécoslovaquie. Ils ne sont pas bien traités. Nous voulons qu’ils fassent partie de l’Allemagne. » Et ils étaient prêts à envahir …
Le Premier ministre britannique, Neville Chamberlain, rencontra Hitler à Munich et conclut un accord selon lequel les parties allemandes de la Tchécoslovaquie seraient rattachées à l’Allemagne. Et ce serait tout. Ce serait tout ce que l’Allemagne demanderait, et l’Occident offrirait quelques garanties de sécurité .
La Tchécoslovaquie n’était pas là . C’était une paix qui leur était imposée.
Et effectivement, un an ou deux plus tard, l’Allemagne disait : « Non, nous voulons toute la Tchécoslovaquie. Et, PS, nous voulons la Pologne. » Et c’est ainsi que la Seconde Guerre mondiale a commencé.
Pouvez-vous préciser davantage les comparaisons ?
La Tchécoslovaquie n’était pas à la table des négociations. L’Ukraine n’est pas à la table des négociations.
Encore une fois, je ne suis pas sûr de vouloir comparer Poutine à Hitler, mais c’est un président autoritaire et fort avec une grande armée .
Des garanties de sécurité ont été accordées à la Tchécoslovaquie, mais elles n’ont pas été respectées. L’Occident a donné des garanties de sécurité à l’Ukraine lorsque ce pays a renoncé à ses armes nucléaires en 1994. Nous lui avons dit : « Si vous êtes courageux et abandonnez vos armes nucléaires, nous veillerons à ce que vous ne soyez jamais envahi. » Et le pays a été envahi à deux reprises depuis, en 2014 et en 2022. L’Occident n’a pas réagi .
L’histoire nous montre donc que les chances d’une paix durable à l’issue de ce sommet sont plutôt faibles.
Quel type d’expertise est requis pour négocier un accord de paix ?
Voici ce qui se passe habituellement dans la plupart des pays dotés d’un important système de politique étrangère ou de sécurité nationale, et même dans certains pays plus petits.
Les dirigeants politiques définissent leur objectif politique, ce qu’ils veulent atteindre.
Et puis ils disent aux fonctionnaires de carrière, aux agents du service diplomatique et aux militaires : « Voilà ce que nous voulons obtenir à la table des négociations. Comment y parvenir ? »
Et puis les experts disent : « Oh, on fait ceci et cela, et on va affecter du personnel pour résoudre le problème. On va collaborer avec nos homologues russes pour essayer de cerner les problèmes, et on va trouver des chiffres et des cartes. »
Avec tous les remplacements de personnel depuis l’investiture, les États-Unis se retrouvent non seulement avec un nouveau groupe de personnes nommées par des politiciens – dont certaines, comme Marco Rubio, connaissent généralement bien leur métier en matière de sécurité nationale – mais aussi avec beaucoup d’autres qui ne savent pas ce qu’elles font. Ils ont également licencié des hauts fonctionnaires et des agents du service extérieur, et beaucoup de cadres intermédiaires partent, ce qui fait que l’expertise fait défaut.
C’est un véritable problème. L’appareil de sécurité nationale américain est de plus en plus dirigé par l’équipe B – au mieux.
En quoi cela constituera-t-il un problème lorsque Trump rencontrera Poutine ?
Deux dirigeants de deux grands pays comme celui-ci ne se rencontrent généralement pas à quelques jours d’intervalle. Il faudrait une véritable crise.
Cette réunion pourrait avoir lieu dans deux ou trois semaines aussi facilement que cette semaine.
Et si cela se produisait, vous auriez l’occasion de vous préparer. Vous auriez l’occasion de présenter toutes sortes de documents aux participants américains. Vous rencontreriez vos homologues russes, ukrainiens et peut-être des pays d’Europe occidentale. Et lorsque les deux parties se retrouveraient autour de la table, les discussions seraient très professionnelles.
Ils auraient devant eux des documents d’information très similaires. Les problèmes seraient alors réduits.
Rien de tout cela n’arrivera en Alaska. Deux dirigeants politiques se rencontreront et prendront des décisions, souvent motivées par des considérations politiques, sans vraiment savoir si elles pourront être mises en œuvre ni comment.
Un accord de paix pourrait-il être appliqué ?
Encore une fois, la situation est quelque peu hantée par le fait que l’Occident n’a jamais appliqué les garanties de sécurité promises en 1994. Je ne suis donc pas sûr que cela puisse être appliqué.
Historiquement, la Russie et l’Ukraine ont toujours été liées , et c’est là tout le problème. Quel est l’objectif ultime de Poutine ? Renoncerait-il à la Crimée ? Non. Renoncerait-il à la partie de l’est de l’Ukraine qui avait été de facto conquise par la Russie avant même le début de cette guerre ? Probablement pas. Renoncerait-il à ce qu’ils ont conquis depuis ? D’accord, peut-être.
Alors mettons-nous à la place de l’Ukraine. Voudront-ils abandonner la Crimée ? Ils répondent : « Non . » Voudront-ils abandonner une partie de la partie orientale du pays ? Ils répondent : « Non. »
Je suis curieux de savoir ce que vos collègues du monde diplomatique disent de cette réunion à venir.
Ceux qui comprennent le processus diplomatique pensent que c’est une approche très amateur et peu susceptible d’aboutir à des résultats concrets et applicables. Cela donnera lieu à une déclaration et à une photo de Trump et Poutine se serrant la main. Certains croiront que cela résoudra le problème. Ce ne sera pas le cas.
Cet article est republié par The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’ article original .
