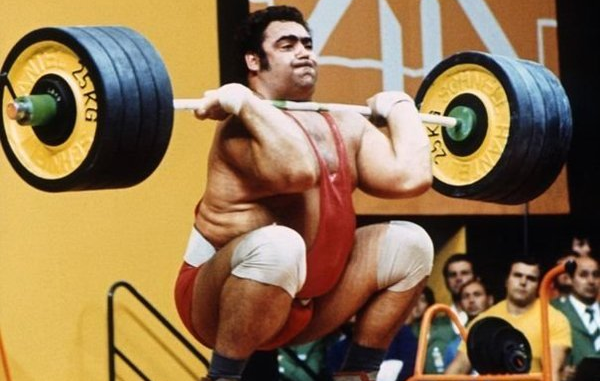
Par Ahmed El-Husseini
L’affirmation la plus révélatrice de Donald Trump sur la paix est aussi celle qu’il répète avec le plus d’assurance : il pourrait « mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures ». Derrière cette fanfaronnade se trouve la logique centrale de sa méthode. Son plan pour l’Ukraine — pousser Kyiv à céder du territoire, lui refuser l’aide militaire et confier la « paix » à Moscou — résume la dynamique qui traverse toutes ses interventions : la paix est ce que veut l’agresseur le plus puissant, précisément au moment où celui-ci a besoin d’une pause pour consolider ses gains. La diplomatie trumpienne ne vient pas confronter la conquête ; elle vient la figer au moment où la puissance conquérante est épuisée et désireuse de verrouiller son avancée. Pour Trump, la prise de territoire n’est pas une violation du droit international : c’est une nouvelle réalité que la partie la plus faible doit accepter. La souveraineté devient négociable ; la seule chose qui ne l’est pas, c’est la carte de l’agresseur.
Les fidèles de Trump en politique étrangère — des envoyés politiques sans véritable expertise — fonctionnent avec des canevas dignes de ChatGPT et les éléments de langage de ceux qui dominent déjà le champ de bataille. Même son émissaire Steve Whitkoff n’a pas nié s’être appuyé sur ChatGPT, se contentant de déplorer que ses recommandations « n’aient pas fonctionné pour Gaza », aveu qui résume à la fois l’amateurisme et la superficialité de toute l’approche. Les divagations de Tom Barrack sur le Levant n’étaient pas différentes — une suite d’affirmations factuellement fausses qui ressemblaient moins à de la diplomatie qu’aux « hallucinations » typiques des outils d’IA auxquels son cercle recourait.
En Ukraine, plusieurs conseillers proches de Moscou ont fourni à Trump une feuille de route présentant la résistance ukrainienne comme l’obstacle à la « prospérité », reprenant la logique de Munich : valider le conquérant, stigmatiser la victime comme un frein à la modernisation et emballer l’accord imposé comme un renouvellement pragmatique. La diplomatie se réduit alors à la transaction : pas d’histoire, pas de justice, pas de responsabilité — seulement un accord et une photo où c’est la partie la plus faible qui paie le prix de l’épuisement de la plus forte.
Cette vision s’accorde naturellement avec l’affinité de toujours de Trump pour les « hommes forts », son admiration instinctive pour les dirigeants belliqueux qui dominent, intimident ou humilient. La force — souvent théâtrale — suscite chez lui respect et légitimité ; la vulnérabilité, elle, appelle la moquerie. C’est cette même psychologie qui l’a conduit à qualifier le sénateur John McCain de « loser » pour avoir été capturé. Dans l’esprit de Trump, la puissance fait la vertu et la faiblesse est une faute morale. Ce n’est pas un trait périphérique : c’est le moteur psychologique de sa politique étrangère. Il se range du côté des forts parce qu’il croit que les forts méritent de gagner.
On retrouve exactement cette logique à Gaza, où Trump affirme avoir « mis fin à la guerre » et « stabilisé le Moyen-Orient ». En réalité, il a adopté sans réserve le plan maximaliste d’Israël, traitant l’État hébreu non comme une partie au conflit mais comme l’arbitre naturel de la région. Les Palestiniens furent totalement exclus : leurs revendications trop gênantes, leurs droits trop « compliqués ». Le résultat fut un gel unilatéral des lignes, consolidant les gains israéliens et laissant Gaza sous occupation de facto. Là encore, l’intervention trumpienne coïncidait avec un moment où Israël — après des mois d’opérations intenses — avait besoin d’une pause tactique pour se réorganiser.La « paix » de Trump servait cet épuisement, non les droits palestiniens. Comme en Ukraine, la victime devint l’obstacle et la carte de l’agresseur, le fondement de la diplomatie.
L’Arménie et le Haut-Karabakh offrent une version encore plus nette de ce schéma. Trump se vante d’avoir obtenu une « paix historique » entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan, mais son accord — voué à s’effondrer — ne fit que ratifier les résultats d’un blocus, de la famine et d’une victoire militaire rapide. Il intervint précisément lorsque l’agresseur — ayant vidé le Haut-Karabakh de sa population arménienne — avait besoin d’une couverture internationale et de temps pour consolider ses gains. L’Arménie n’eut aucun siège à la table ; son peuple, aucun droit, aucune justice. Les émissaires de Trump, certains proches de Bakou, intégrèrent presque mot pour mot la rhétorique azerbaïdjanaise dans des propositions estampillées Washington.
Le « corridor de prospérité » du Syunik fut vendu comme modernisation, bien qu’imposé sous contrainte — Munich réemballé en infrastructure. L’inversion morale fut totale : la victime fut présentée comme un frein au développement régional, et le nettoyage ethnique, comme une opportunité commerciale.
Même le Yémen reflète cette méthode à un seul tour. Trump insiste avoir « arrêté les Houthis » et « sécurisé la paix maritime », alors que la seule chose qu’il négocia fut une exemption pour les navires américains — à l’instant même où les Houthis cherchaient eux-mêmes une pause tactique après des mois d’escalade. Il n’y eut ni cessez-le-feu, ni désarmement, ni réduction des capacités des Houthis. Les alliés — Israël compris — furent laissés exposés. Ce n’était pas un accord de paix : c’était une exemption transactionnelle, façonnée autour des besoins temporaires de l’agresseur et des priorités étroites de Trump.
À travers ces crises, le schéma est clair. Trump exagère et dramatise, mais sa vision reste cohérente : la paix revient au plus fort, et le plus faible doit être pressé, amadoué ou humilié pour accepter les termes du vainqueur — surtout au moment où ce vainqueur a besoin de se réorganiser. Les conflits deviennent des litiges immobiliers : le territoire appartient à celui qui le détient au crépuscule. C’est plus simple que la diplomatie, moins coûteux que la stratégie, et parfaitement calibré pour la caméra.
D’où la pertinence de la comparaison à Munich. Trump ressuscite cette logique dans sa forme la plus concentrée : valider le conquérant, blâmer la victime, et transformer des concessions forcées en percées diplomatiques. Ses accords ressemblent à la paix uniquement parce qu’ils figent la violence au moment où l’agresseur est épuisé. La justice disparaît, la mémoire s’efface, et l’asymétrie devient doctrine.
Il se vante d’une longue liste « d’accords de paix » — de Gaza et du Karabakh à l’Ukraine, au Yémen, au Congo–Rwanda, au Soudan, à Haïti, à la Serbie–Kosovo et à la mer Rouge. Aucun n’est un règlement véritable. Tous partagent la même architecture : le fort dicte, le faible capitule, et Washington certifie l’arrangement avec emphase.
Ce sont des plans de consolidation. Et il reste à voir si l’un de ces accords fragiles survivra au temps qui reste à son mandat.
Ce que Trump propose, c’est un retour à un ordre pré-libéral où la force fait le droit et où l’épuisement remplace la négociation. Une paix sans justice, une stabilité sans légitimité, un ordre sans consentement. Normalisée, cette méthode ne mettra pas fin aux conflits ; elle apprendra à chaque agresseur que la conquête paie — surtout lorsqu’elle est mise en scène par un président avide d’applaudissements.
Voilà la paix à un seul tour — et ce n’est en rien une paix durable.
